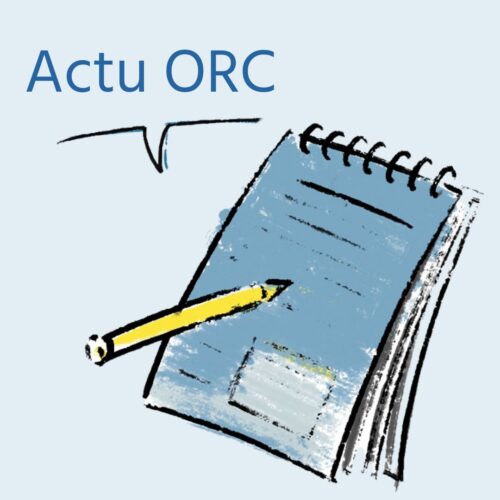
Culture et loisirs : quelles différences ?
L’ORC mène une étude sur les activités culturelles et de loisirs des Suisses romand·es, prévue pour l’automne 2025. Dans l’intervalle, nous publions une revue de la littérature.
L’Observatoire romand de la culture mène actuellement une enquête sur les activités culturelles et de loisirs des Suisses romand·es. L’objectif de cette étude est de documenter les enjeux liés aux publics de la culture, à mieux comprendre leurs pratiques et à identifier les défis actuels et futurs des politiques publiques. La publication de l’étude est prévue pour l’automne 2025. Dans l’intervalle l’ORC publie une revue de la littérature.
Deux notions imbriquées
Avant d’aborder les travaux existants sur les pratiques des Suisses romand·es, il est important de clarifier la distinction entre les activités culturelles et les activités de loisirs, deux notions souvent imbriquées mais aux contours conceptuels et sociaux parfois différents. L’UNESCO opère une distinction entre les activités culturelles, entendues comme vecteurs d’expressions culturelles indépendamment de leur valeur économique, et les activités de loisirs, définies comme des pratiques récréatives visant le divertissement ou la détente. La question de savoir si les activités culturelles et les loisirs doivent être regroupés dans une même catégorie fait l’objet de débats et de perspectives clivantes.
Cette distinction a été testée au Mucem, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Des visiteur·euses ont été interrogé·es sur la séparation entre culture et loisir, ainsi que sur une conception extensive et ouverte de la culture. Selon les résultats, 87 % des répondant·es considèrent que les activités culturelles et les loisirs sont proches et souvent indissociables (Doduik, 2020). Ces résultats suggèrent que la population interrogée perçoit ces deux activités comme liées.
La distinction entre culture et loisirs, bien qu’encore débattue théoriquement, est peu abordée dans les enquêtes empiriques sur les pratiques culturelles. En Suisse, plusieurs travaux ont choisi de regrouper ces deux dimensions pour mieux rendre compte de la diversité des comportements des individus. C’est le cas de l’enquête thématique Langue, Religion et Culture (ELRC), menée tous les cinq ans par l’OFS sur les pratiques culturelles et de loisirs de la population. Un autre exemple est l’ouvrage Sociologie des classes populaires contemporaines, de Yasmine Siblot et coll. (2015), dont le chapitre 5 se concentre sur les pratiques culturelles et de loisirs des classes populaires.
La consommation culturelle évolue
Quelques études se sont intéressées aux pratiques des Suisses romand·es en matière d’activités culturelles et de loisirs. L’enquête ELRC de l’OFS, qui porte sur ces pratiques, fera l’objet d’une nouvelle publication en novembre 2025. Une étude menée en 2019 par Statistique Vaud, en collaboration avec le Service des affaires culturelles, s’est penchée sur les pratiques culturelles dans le canton. Enfin, l’étude « Les publics de la culture à Lausanne » (Moeschler, 2019b) propose une analyse détaillée de ces pratiques au niveau local. En dehors de la Suisse romande, d’autres études ont également été réalisées pour explorer ces pratiques.
Des chercheur·euse·s ont étudié comment la consommation culturelle évolue en Suisse au fil des décennies, soulignant que les comportements culturels changent progressivement, devenant plus accessibles et contribuant à estomper la distinction entre « culture élitiste » et « culture de masse » (Weingartner, 2019).
À l’échelle internationale, plusieurs études ont été menées pour explorer ces questions. En France, l’Observatoire Société & Consommation a exploré en 2020 le rapport des Français·es aux loisirs (incluant la culture), tandis qu’au niveau européen, Eurostat a publié en 2024 un rapport sur la participation culturelle dans les pays de l’Union européenne. Ces recherches montrent l’importance de suivre ces évolutions pour mieux comprendre les dynamiques culturelles actuelles.
La mobilité : un enjeu clé
Il convient à présent d’examiner les données existantes en lien avec les différentes sous-questions que cette étude de l’ORC entend explorer, afin d’ancrer l’analyse dans les travaux antérieurs et d’identifier les apports potentiels de cette recherche.
Ce sont surtout les types d’activités culturelles et de loisirs pratiquées qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’études. En France, les pratiques culturelles les plus fréquentes sont : le cinéma (62 % des Français·es y vont au moins une fois par an), les spectacles de rue (45 %), les visites de monuments historiques (35 %), les concerts (34 %), les fêtes foraines (31 %), et les musées ou expositions (29 %) (Glevarec, 2024).
Les pratiques évoluent avec le temps. On observe ainsi une baisse de la télévision, de la radio, de la lecture des journaux et des livres, tandis que les activités liées aux écrans sont en augmentation (Donnat, 2009a). Cette tendance est confirmée par l’ELRC de l’OFS (2019), qui montre une augmentation des pratiques culturelles à domicile (notamment via écrans) par rapport aux activités en présentiel. En revanche, il existe peu d’études sur les alternatives aux activités culturelles chez les personnes qui participent peu ou pas à la vie culturelle, ce qui constitue une lacune dans la littérature.
La mobilité est un enjeu clé lié à la participation du public aux offres culturelles. En 2019, le rapport Ruralités a mis en évidence les préoccupations des habitant·e·s des zones rurales face aux difficultés d’accès, notamment en matière de mobilité, en France (ministère de la Culture, 2024). Ces constats soulignent l’importance d’examiner cette problématique en Suisse romande, où les disparités territoriales peuvent aussi influencer l’accès à la culture et la participation des publics.
En France, malgré les politiques d’aménagement culturel menées depuis plusieurs décennies, l’offre reste largement concentrée dans les grands centres urbains, comme le confirme le rapport du ministère de la Culture française en 2022. Dans ce contexte, la mobilité apparaît comme un facteur déterminant, puisqu’elle conditionne directement la possibilité pour les individus de participer à la vie culturelle. Étudier cette question en Suisse romande permet ainsi de mieux comprendre comment les publics s’organisent face à ces contraintes d’accès.
Notion de « découvrabilité »
La connaissance de l’offre culturelle et de loisirs constitue un facteur déterminant des pratiques individuelles, influençant la manière dont les personnes s’informent, planifient et participent aux activités proposées. L’accessibilité à cette offre peut être analysée à travers le concept de « découvrabilité » (Grenier et al., 2025), qui dépasse le simple référencement web. Selon la Mission franco-québécoise, la découvrabilité désigne « la disponibilité d’un contenu en ligne et sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d’autres contenus, même par une personne qui n’en recherchait pas spécifiquement » (ministère de la Culture, 2020). Cette notion englobe à la fois la « trouvabilité »par une recherche active et la découverte fortuite (sérendipité).
Concernant la question de savoir si l’offre répond aux attentes du public en termes de diversité, d’accessibilité et de coûts, les recherches restent limitées. Une partie de la littérature récente met en garde contre une approche fondée uniquement sur la « demande », telle qu’exprimée ou amplifiée par les mécanismes des plateformes numériques (Marguerin, 2015). Dans cette perspective critique, il est nécessaire de se demander si les indicateurs actuels de satisfaction reflètent véritablement des attentes culturelles construites sur le long terme, ou s’ils traduisent simplement des comportements de consommation dictés par l’instantanéité et la logique marchande.
Rôle du numérique
Enfin, avec les transformations sociétales liées au numérique, la consommation d’activités culturelles et de loisirs évolue également. Le numérique constitue un levier important pour favoriser la démocratisation de la culture : il permet de surmonter les obstacles liés à la mobilité, aux contraintes de programmation ou à la localisation géographique des offres (Ministère de la Culture, s.d.). Déjà en 2009, plus de la moitié des Français·es de moins de 45 ans utilisaient Internet durant leur temps libre (Donnat, 2009), ce qui témoigne de la généralisation progressive de ces usages. Cette dynamique se confirme en 2019, où l’activité la plus répandue en moyenne hebdomadaire est l’écoute de musique (7,5 heures), suivie de l’usage d’Internet à des fins de divertissement ou de ressourcement (7,4 heures) (Moeschler, 2019a). Il est important d’étudier également le degré de satisfaction associé à ces pratiques, un aspect encore peu exploré dans la recherche actuelle.
Bien que certaines recherches aient été menées en Suisse sur les pratiques culturelles et de loisirs, celles-ci restent ponctuelles et fragmentées. La plupart se concentrent sur des zones géographiques précises (comme le canton de Vaud ou la ville de Lausanne) ou sur des aspects spécifiques des pratiques culturelles, sans proposer de vision d’ensemble. À ce jour, aucune étude ne semble avoir abordé de manière intégrée l’ensemble des dimensions explorées par la présente enquête — en particulier en Suisse romande — à savoir : la fréquence et la diversité des pratiques, la mobilité et l’accès à l’offre, la satisfaction et l’adéquation de l’offre, les modes de découverte et d’accès à l’information, les pratiques des non-participant·es, ainsi que l’impact du numérique.
Cette lacune dans la littérature justifie pleinement l’intérêt d’une approche globale à l’échelle romande, telle que celle proposée par cette étude de l’ORC, dont la parution est prévue pour l’automne 2025.